| ACCUEIL | LE BROL | LE JUTE |

plusieurs "rolles"s'alignent, les unes à côté des autres, devant la "carde briseuse" ou le ruban sera "étiré".
De la graine semée sur les rives du Gange au sac fabriqué sur les bords de la Deûle. La petite histoire d' une balle de jute
— Connaissez-vous quelque chose au jute ? Le directeur d'un important établissement de jute de ia banlieue lilloise me pose cette question embarrassante. Un sourlre gêné me dispensa de toute réponse.
— Et le textile, en général, en avez-vous quelque idée ? Bien sûr, il y a des filatures et des tissages. A la filature, on file, et au tissage, eh bien, on tisse. Là se bornait, je l'avoue à ma honte, mes connaissances eur ce sujet.
— C’est autrement complexe. Vous serez sans doute surpris de vojr les nombreuses manipulations que subit une balle de jute avant d’arriver au produit fini.
Le chef de service qui devait me piloter au cours de cette visite me rassura :
— Vous verrez, ce n’est pas bien terrible. Avec un peu d attention, vous suivrez assez facilement la progression.
Mais si jamais, il vous était donné de visiter une usine textile. retenez bien ceci : sortir de sa poche un paquet de cigarettes équivaut à un geste presque sacrilège
Premler arrêt dans un vaste entrepôt ou les balles de Jute grimpent jusqu’au plafond noirci. Arrivant des Indes en droite ligne, elles se présentent sous un assemblage de poignées fortement comprimées à la presse hydraulique pour réduire leur volume.
Les balles sont stockées suivant leur qualité, correspondant généralement à leur lieu d'origine. Je rélève au hasard quelques fiches d’identité : Dundee firsé 2/3, Dundee heatts, Mills heatts...
Un chariot élévateur savance en ronronnant. Deux barres mobiles, semblables à des lèvres proéminentes, happent une balle. Puisque le hasard nous en don ne l'occasion, suivons donc cette balle tout au long de ses pérégrinations.
Auparavant, rnon guide montre du doigt les taches noirâtres qui souillent les murs et le plafond."Nous avons eu un incendie, il n’y a pas bien longtemps". Le feu, ennemi No 1 du jute et du textile en général.
Les poignées de jute ainsi amalgamées forment des plaques extrêmement dures. La balle, que nous avons vue tout à l'heure est déchargée devant "l'ouvreuse." Comme son nom l'indique, cette machine, formée de rouleaux hérissés de pointes, "ouvre" les plaques qui passent ensuite â la "départageuse". Elles en sortent en poignées, déjà plus souples. Ces poignées sont alors avancées dans l’ "étaleuse". En même temps qu’elles subissent un nouvel assouplissement mécanique, on projette sur les fibres une émulsion d’huile minérale et d eau, "l’ensimage", qui doit faciliter les opérations ultérieures. Les fibres sont peignées et parallélisées.
A la sortie, le jute se présente sous l’aspect d’un large ruban assez grossier, large d’une vingtaine de centimètres, qui, s’enroulant sur lui-même, forme une "rolle"
Nous allons assister maintenant à un curieux phénomène d’assimilation. Les "rolles", au nombre de six, sont disposées, les unes à côté des autres, devant la "carde briseuse".
Le cardage a pour but de débarrasser le jute de toutes les impuretés qiril contient encore et de rendre le ruban plus homogène, par un "doublage" accompagné d’un "étirage". Ces termes techniques suffisamment expressifs, me dispensent de les traduire "en clair".
Cette opération se fait en deux temps ; d'abord le ruban passe sur la carde briseuse. Des six "rolles » engagées", il n'en subsiste qu’une seule à la sortie. Deuxième temps : les rubans passent à la carde finisseuse qui complète le travail.
Soixante rolles donnent un petit ruban, joliment plissé, large de 1,5 centimètre.
La matière ainsi préparée, l’opération filature commence.
Devant moi, s’alignent les métiers à filer classiques. Ils portent chacun 100 broches à ailettes suspendues. Le ruban plissé, étiré et tordu, se transforme en un fil d'épaisseur voulue : 4.5 — ce qui signifie 4.500 mètres de fil par kilo — 3,6, 3, 2,4, selon l'usage auquel on le destine. Le démontage des bobines sur lesquelles le fil s’enroule se fait automatiquement, limitant l’intervention du "conducteur" réduisant les temps morts. Le fil ainsi obtenu peut être destiné soit à la "chaîne" soit à la "trame".
Par chaîne, entendez les fils courant dans le sens de la toile, par trame, les fils perpendiculaires aux précédents. Les fils chaîne sont mis sous forme de "rolls" qui ressemblent à des pâtés de sable. Le fil s’enroule sur un tube de bois ou de carton, guidé par un rouleau cannelé. Le fil destiné à la trame est fixé sur "l'épeuleuse" ou "coconneuse". Les substantifs ne manquent pas dans le textile ! Les broches sont fixées perpendiculairement à un disque vertical rotatif. Les "cocons" s’évacuent automatiquement quand ils ont atteint l’épaisseur voulue. Laissons pour l'instant les cocons que nous retrouverons tout à l'heure, à l'atelier de tissage
Les fils "chaîne" qui, au cours des opérations ultérieures et de l'emploi du produit fini, auront à supporter le plus gros des efforts, doivent encore subir une certaine préparation. En effet, pour qu’ils puissent être utilisés sur le métier à tisser, ils doivent être enroulés parallèlement entre eux et sous une même tension. Cette opération s’effectue sur l’ourdissoir. Tout à l'heure, à la filature, j’avais été surpris par le calme et le Peu de poussière. Cela bouleversait mes idées préconçues. Le public non initié se représente ainsi une usine textile : les ouvrières portent un fichu noué autour de la tête ;le bruit est terrible, l’air irrespirable.
Je commençais à reviser sérieusement mes conceptions quand, en passant dans la pièce où fonctionnait l’ourdissoir, je trouvai un univers familier.
Changement de décor. L’air s’épaissit de milliers de brins de jute qui s’accrochent désespérément à mes vêtements. Bon signe ; la fibre "a du crochet" : rugueuse, elle se travaillera mieux.
Sur un râtelier, le "cantre", sont fixées les "rolls". Les fils glissent sur des plots de porcelaine, passent dans un peigne qui les répartit régulièrement sur l' "ensouple". tambour cylindrique qui, en tournant sur un axe horizontal, donne la tension voulue.
L’ "ensouple" ainsi obtenu ne comporte pas encore assez de fils. On groupe donc plusieurs ensouples — le nombre varie avec le "serré" de la toile qu’on veut obtenir. Mais le fil est encore trop souple pour se prêter convenablement au tissage. Il lui faut acquérir une certaine raideur. Cette double opération "l’encolleuse" la réalise. Les fils, doublés et peignés une nouvelle fois passent dans le bac à colle (la colle est exclusivement composée d’eau et de fécule de pommes de terre) et s’engagent dans le séchoir. A la sortie, la nappe de fils s’enroule sur l’ensouple qui sera utilisé en tissage.
Monde étrange que celui où nous pénétrons maintenant. Des centaines de courroies semblent devoir s’emmêler dans leur ronde infernale. Le bruit domine tout et j'entends à peine ma voix quand je hurle, demandant des précisions à mon cicérone. Un rythme syncopé qui mettrait en transes le plus paresseux des fervents du be-bop, martèle le crâne. Les ouvriers ne se rendent plus compte du bruit, paraît-il. C’est un élément de leur travail.
Connaissez-vous le principe du métier à tisser? Tenez, un exemple. Quand madame ravaude les chaussettes, elle tisse d'abord une série de fils parallèles. Appelons-les fils de chaîne. Ensuite, perpendiculairement à ces fils, elle passe l’aiguille alternativement au-dessus et en dessous. L’aiguille, c’est la navette et le fil qu’elle entraîne, le fil de trame. Cette comparaison ne vaut bien sûr que pour le métier à tisser rectiligne.
Les cocons que nous avons laissés tout à l’heure se glissent, dans les navettes. Des lames, les "lisses" soulèvent alternativement les fils de rang pair et de rang impair. Les " fouets", bras de bois maintenus par des sangles de cuir, se renvoient la navelte. Un peu du jeu "à toi, à moi". assez agréable à regarder s'il n'était aussi bruyant à entendre. Le fil de trame est ensuite pressé par un peigne contre la toile déjà tissée.
Le métier rectiligne a été modernisé. Des chargeurs au'omatiques glissent les cocons dans les navettes, sans arrêt de l’ensemble. En outre, des systèmes de casse-chaîne et de casse-trame provoquent l’arrêt du métier dès qu’un fil se rompt.
Un peu précieux, ne voulant pas se commettre avec les anciens métiers, voici le métier circulaire, le dernier cri de la technique en textile. Il n'y a pas d’innovations sensationnelles. Le principe reste le même. Seuls la présentation et le résultat diffèrent.
Les navettes, leur nombre est variable, trois ou quatre généralement, sont constituées par des cylindres de métal à l’inférieur desquels sont placés les cocons ; les navettes sont fixées perpendiculairement à un plateau horizontal. La toile n’affecte plus la forme d’une nappe mais d’un cylindre. Moins encombrant, moins bruyant, il vaut, grâce au nombre de ses navettes et à leur vitesse de rotation, trois à quatre métiers rectilignes.
Le rideau va bientôt tomber. nous voici au dernier acte, celui de la confection. Auparavant, la toile va subir encore quelques petites opérations qui la feront coquette : mouillage, calandrage, où des rouleaux jouent les fers à repasser, manglage qui ferme le tissu en bouchant les interstices qui peuvent subsister entre la chaîne et la trame.
La toile provenant des métiers rectilignes est "dossée", c’est- à-dire, pliée en deux dans le sens de la longueur.
Une chaîne restreinte, formée uniquement d’ouvrières, prend la toile en mains. Premier temps : les bordures latérales sont fermées au point de surjet. Deuxième temps : les bords de l’ouverture sont rabattus et ourlés. L’habileté de ces ouvrières est remarquable. Une surjeteuse confirmée peut faire 2.000 sacs par jour. Troisième temps : le sac passe à la machine à imprimer qui reproduira la "marque" du propriétaire. Quatrième temps : le sac est retourné mécaniquement. Et voici notre sac de jute déclaré "bon pour le servic". Demain, il transportera des pommes de terre ou du charbon, du sucre ou de l’engrais. Il n’empêche qu’une quinzaine d’opérations ont jalonné sa transformation.
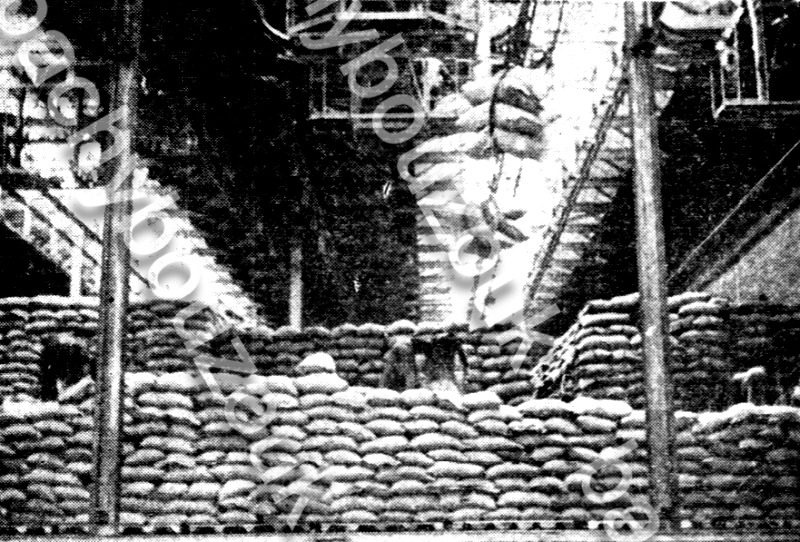
La fabrication de sacs rete le principal objet du jute : pour l'agriculture (pommes de terre,...),le café, le transport du charbon, ...
___________________________________________
| ACCUEIL | LE BROL | LE JUTE |
bachybouzouk.free.fr